14 mars 2025
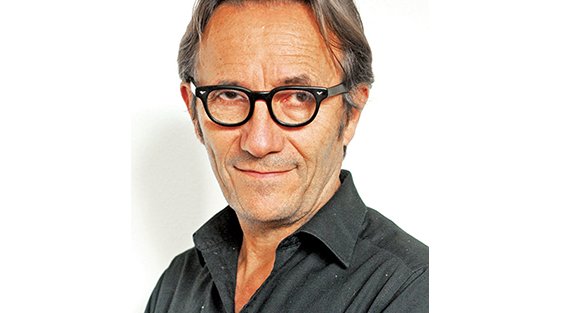
L’edito de JMC s’intéresse au pragmatisme allemand cette semaine : un exemple à suivre ?
Parmi les qualités attribuées à nos voisins allemands, celle du pragmatisme. Il leur permet de régler les problèmes et d’apporter des solutions au cours de discussions autour d’une table entre adultes consentants. Les syndicats y sont aussi influents que responsables et aboutissent généralement à des accords équilibrés. L’économie comme les travailleurs ne semblent pas s’y porter plus mal que chez nous...
Ce pragmatisme permet aussi à nos cousins très germains d’avoir des finances publiques dans un état que l’on pourrait leur envier de ce côté du Rhin si nous ne portions pas seuls la responsabilité d’un déficit abyssal creusé avec persévérance en cinquante années de dépenses non maîtrisées, de renoncements, pour tout dire d’un manque de courage politique partagé par la droite et la gauche.
Toujours au nom du pragmatisme, et nonobstant la virulence des associations écologistes, l’Allemagne a décidé sans plus attendre de faire passer à la trappe onze Zones à Faibles Émissions (ZFE) au moment où, en France, nous persistons à déployer ces mesures qui enquiquinent ceux n’ayant pas les moyens d’acquérir un véhicule électrique ou hybride neuf. De la même façon, par réalisme, Bruxelles a décidé de reporter les taxes prévues sur les motorisations essence et diesel des véhicules neufs, bien consciente que les industriels ne peuvent pas matériellement décarboner aussi vite que les technocrates administrativement. Mais la France instaure maintenant de nouvelles taxes sur les véhicules neufs à essence, y compris pour les modèles les plus modestes... Si comparaison n’est pas raison, nous pourrions avoir la modestie de jeter de temps à autre un coup d’œil par la portière pour voir ce qui réussit chez nos voisins et dont nous pourrions nous inspirer. Par pragmatisme, bien sûr...
Les vingt-sept pays européens ont « gelé » quelque 250 milliards d’euros d’avoirs russes depuis le début de la guerre en Ukraine. Des sommes qui sommeillent à Bruxelles. Certains sont tentés de les utiliser pour financer l’effort militaire indispensable face à Moscou. Mais ce n’est pas aussi simple. Et si Poutine ne s’embarrasse pas du droit international, confisquer ces milliards serait contraire aux accords internationaux. Il n’est donc guère possible de piocher dans cette tirelire, comme certains appellent à le faire, d’autant qu’elle appartient à la Banque centrale de Russie, qui a placé à « l’Ouest » ses petites économies. Ce serait évidemment un mauvais signal envoyé aux marchés financiers, qui pourraient perdre confiance dans l’Europe et aller voir ailleurs.
Mais les partisans de la confiscation ont de la mémoire et rappellent l’existence d’une jurisprudence internationale : les Américains ne se sont pas privés de saisir les avoirs japonais lors de la Seconde Guerre mondiale. Idem pour des avoirs iraniens et afghans, saisis par ces mêmes Américains pour indemniser les victimes de ces régimes. Au printemps dernier, l’administration Biden a aussi fait adopter une disposition pour saisir les avoirs russes... sans la faire appliquer.
Beaucoup de pudeur, donc, sur le nerf... de la guerre, alors que les grands principes sont moins souvent rappelés après les attaques qui massacrent des civils innocents. Depuis plus d’un an, les Vingt-Sept utilisent déjà les profits et intérêts dégagés par les avoirs russes gelés pour aider l’Ukraine et financer sa reconstruction d’après-guerre. C’est évidemment moins « rentable » qu’une confiscation pure et simple.
Mais peut-être davantage... pragmatique ?
 Jean-Michel Chevalier
Jean-Michel Chevalier